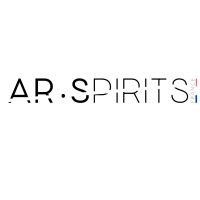Cet entrepreneur charentais, autodidacte, champion de France de dégustation de vin à 24 ans, démarre très fort avec sa marque de vins d’exception
Antoon Laurent, Charentais d’adoption, parle avec passion du vin. Et pour cause, il en a fait son métier, son entreprise, sa vie. Plus de 20 ans qu’il parcourt les vignobles français chaque semaine, pour le plaisir de l’échange, des rencontres, du partage autour du vin, confie-t-il. À 40 ans, son histoire s’apparenterait presque à celle d’un roman, tant son chemin a croisé celui d’illustres personnalités dans le milieu du vin. Il vous parle sans pareille de Petrus, d’Yquem, de Jayer, de Romanée-Conti et tant d’autres, avec la sincérité d’un enfant et la précision d’un orfèvre. Découvrez l’histoire surprenante de cet inclassable entrepreneur charentais qui a créé sa marque de vins d’exception il y a moins de deux ans, dont la dernière cuvée a déjà été réservée avant même qu’elle ne soit embouteillée.
L’entrepreneur charentais : Antoon, peux-tu nous parler de ton parcours, jusqu’à la création de ton entreprise ?

Antoon Laurent : Je suis né le 8 février 1976 à Sainte-Colombe-lès-Vienne au nord de la Côte-Rôtie, dans un milieu viticole où tout se faisait à dos d’homme. J’ai la chance d’avoir vécu chez des parents qui adorent manger, qui adorent boire, et de bonnes choses de préférence. Mon grand-père était agriculteur. Les produits que nous mangions alors étaient ceux de la ferme, issus de la polyculture à l’ancienne.
Enfant, je n’ai jamais vraiment su quoi faire de ma vie, je n’étais pas très fort à l’école. J’ai eu zéro de moyenne en dictée et en poésie pendant toute ma scolarité, jusqu’en 3e. Je n’étais pas une flèche. J’ai toutefois réussi à passer en classe supérieure, avec la moyenne tout juste, à chaque fois. Heureusement, j’étais bon en maths et en physique chimie où j’avais des 19 ou des 20 sur 20.
J’ai bossé dès l’âge de 16 ans. J’ai travaillé dans les vignes, dans l’industrie, j’ai curé des fosses septiques… Bref. J’ai fait plein de boulots différents jusqu’à l’âge de 20 ans. C’est à ce moment que j’ai su que je voulais bosser dans le vin. En parallèle, depuis l’âge de 18 ans, je passais tous mes week-ends et mes congés à voyager en France pour visiter des vignobles, goûter des vins, m’instruire. J’allais les voir, et je leur proposais de travailler en échange du gîte et du couvert. C’est surtout comme ça que j’ai appris : à tailler dans telle propriété du Bordelais, à effeuiller dans telle maison de Champagne, etc. Un vrai pèlerinage œnologique finalement.
À 21 ans, j’ai passé mon baccalauréat. Je voulais faire des études de sommellerie. Mais ça n’a pas marché. Alors, je me suis rabattu sur un BTS viticulture-œnologie à Bordeaux, que j’ai obtenu en 1999. J’avais 23 ans. En parallèle, durant mes études, je travaillais le soir, en tant que sommelier, dans un restaurant étoilé Michelin.
En 2000, de nouveau refusé en sommellerie, j’ai poursuivi avec un BTS technico-commercial en boissons, vins et spiritueux à Beaune. Un bel endroit quand on est passionné de vin comme moi.
Durant mes études supérieures, j’ai toujours eu de bonnes notes, alors que j’ai été nul jusqu’au bac. En fait, j’étais parmi les meilleurs élèves. D’ailleurs, on m’avait inscrit au championnat de dégustation des jeunes professionnels du vin où j’ai terminé champion de France en 2000.
J’ai eu la chance de rencontrer plein de gens dans le milieu du vin. L’une de ces rencontres a été déterminante : celle avec Eduardo García Montaña, un étudiant espagnol. Son papa s’occupait d’une grosse propriété. On s’est liés d’amitié. Tous les samedis soir, le repas était basique, mais toujours accompagné d’un super bon canon. On claquait nos économies pour acheter de bonnes bouteilles, les premières qu’on pouvait s’acheter. Je me rappelle un Latour 1980… Je lui avais dit que je voulais être sommelier. Je ne lâchais pas… Et grâce à lui, j’ai été sommelier pour Jesùs Ramiro, qui était à l’époque le cuisinier de la reine d’Espagne. C’était à Porto Rico, j’avais 24 ans.
De retour en France, j’ai réalisé un stage dans une propriété à Blaye. J’avais envie de travailler avec mes méthodes. Par exemple, il m’arrivait de mettre mon réveil à 2 heures du matin pour aller extraire une cuve provenant d’une parcelle de vigne que j’avais repérée. Et ça a plu à mon patron. À tel point que deux mois plus tard, il me proposait de devenir directeur technique de ses deux propriétés. J’avais toujours 24 ans à cette époque-là. En parallèle, j’étais consultant technique pour d’autres propriétaires. Et je continuais, sur mon temps libre, à goûter du vin chez plein de gens, au travers de mes voyages.
En 2004, les dirigeants m’ont proposé de me payer une école d’ingénieur. J’ai réussi le concours et suis devenu, en 2007, ingénieur en gestion économique des entreprises et en gestion de l’aménagement rural, en parallèle de mon job à plein temps.
En 2008, pour me rapprocher de ma copine, j’ai décidé de trouver un emploi à Cognac. Je me suis fait embaucher comme expert technique chez Vicard, où j’intervenais également en recherche et développement. Cela m’a permis de voyager en France, en Espagne, en Suisse notamment. J’ai eu beaucoup de chance. Je suis passé par tous les postes de la tonnellerie, un métier qui ne s’apprend pas dans les livres. J’ai suivi tout le cursus, de l’achat du bois jusqu’à la vente des barriques, en passant par la fabrication. J’ai énormément appris.
En 2013, à 37 ans, je me suis à nouveau retrouvé sur le marché de l’emploi. Je cherchais du boulot et je ne trouvais pas. Au bout de deux mois, un chasseur de têtes m’a contacté et m’a dit : « Monsieur Laurent, avec un CV et une personnalité comme les vôtres, vous ne rentrerez dans aucune case. Sois vous êtes PDG, sois vous créez votre boîte. » Ça a fait son chemin. C’est l’année où je me suis intéressé à la création de mon entreprise.

E.C. : Tu as créé ton entreprise en Charente il y a à peine deux ans. Que fait-elle ? Quels produits ? Comment la commercialisation se déroule-t-elle ?
A.L. : J’ai eu l’idée de créer ma boîte en juin 2013. À cette époque, je commençais à penser à mes assemblages, je rencontrais des gens… Je me préparais. C’est en 2015 que j’ai créé ma marque, « Jeantet Laurent », du nom de mon épouse et du mien. C’est très important pour moi. On forme un couple, une équipe. Heureusement qu’elle est là.
J’ai choisi des parcelles, que je connaissais depuis plus de 20 ans, où j’y avais mis les pieds ou les mains à la taille. Et j’y fais mon vin, selon un cahier des charges très précis, que j’ai formulé. Je participe à toutes les phases. Aussi, toutes les parcelles que j’ai sélectionnées ont une histoire incroyable en passant par Jules César, Thomas Jefferson…
J’ai commencé en concevant un Côte-Rôtie et un Nuits-Saint-Georges. Puis j’y ai ajouté Condrieu, Chablis, Saint-Joseph, Saint-Aubin, Languedoc et d’autres. J’ai également conçu un vin suisse : un pinot blanc d’exception. J’en suis très fier. Aujourd’hui, ma gamme compte dix vins, que je renouvelle chaque année. Les prix se situent entre 10 et 70 €. Et je ne produis que 1 000 à 2 000 bouteilles par référence. Côté commercialisation, j’ai beaucoup travaillé. Mais j’ai aussi beaucoup de chance. Toute ma production est vendue. Le 2016 n’est même pas encore sorti, que tout est déjà réservé. En réalité, il y a une liste d’attente sur tous mes vins. J’alloue un volume de bouteilles à mes clients pour contenter tout le monde, et particulièrement les premiers à m’avoir suivi. J’espère que ça va durer. Je croise les doigts.
E.C. : Ton entreprise semble bien lancée ! On entend qu’il faut souvent attendre avant de se payer son premier salaire. Qu’en est-il pour toi ?
A.L. : La société n’a pas pu me verser de salaire la première année. Et je ne parviens toujours pas à en vivre pour le moment. En même temps, il s’agit de parcelles d’exception, sur de petits volumes. J’ai de très hautes exigences en matière de production. Quand certains mettent 10 centimes dans un bouchon, j’y investis dix fois plus, je sélectionne les meilleures qualités de bouteille… Bref. Tout cela a un prix. Et puis, même si je travaille une gamme de vins d’exception, je souhaite que mes vins soient accessibles. Au final, ma marge est très faible, et je réinvestis tout dans mon entreprise.
J’ai travaillé pour Marcel Guigal, une autre rencontre très importante pour moi. Il m’a fait comprendre que les choses ne se faisaient pas toutes seules. Des étoiles filantes, on en a vu plein dans notre milieu. Je crée une marque. Je ne veux pas brûler les étapes. Ça prendra son temps. C’est un rythme que j’accepte. Je me suis donné dix ans. C’est déjà un miracle ce qu’il m’arrive. Je ne pensais pas pouvoir monter ma gamme aussi rapidement. Et puis, je n’ai pas pour ambition de gagner beaucoup d’argent. Je souhaite seulement vivre de ma passion.
E.C. : À quoi comparerais-tu ton entreprise ?
A.L. : À un livre. L’objectif de mes vins, c’est de transmettre une interprétation, une vision d’un terroir. C’est une histoire, celle d’un lieu. C’est ce que j’essaie de transmettre dans chacune de mes bouteilles.
E.C. : Tu as dit être nul jusqu’au bac, et tu as pourtant plusieurs diplômes en poche aujourd’hui, dont celui d’ingénieur. Comment expliques-tu cela ?
A.L. : Au départ, quand j’ai fait l’ENITA (École nationale d’ingénieurs des travaux agricoles), c’était juste pour avoir un diplôme d’ingénieur. Quand tu es ingénieur, et que tu dis des conneries, on t’écoute mieux que quand tu as un bac et que tu dis des vérités. C’est le constat que j’ai fait. S’agissant de l’école, je pense qu’elle ne me correspondait pas. Et je crains que ce ne soit pas adapté à beaucoup de monde malheureusement.
E.C. : Tu as appris le Robert Parker par cœur, qui compte plus de 1 200 pages. C’est bien ça ?
A.L. : En effet. Tous les jours, pendant une grosse année, j’ai appris par cœur toutes les pages du Parker des vins. Et le Larousse aussi. J’avais 23 ans. Je connaissais les notes, les noms, tout… C’était passionnant. J’avais l’impression de littéralement déguster les vins. Et puis, je les goûtais ensuite, à côté, pour savoir si c’était vrai ou pas. Ça m’a énormément aidé dans la dégustation. Mais la dégustation ne fait pas tout, tu sais. C’est juste un jeu.

« Au départ, quand j’ai fait l’ENITA, c’était juste pour avoir un diplôme d’ingénieur. Quand tu es ingénieur, et que tu dis des conneries, on t’écoute mieux que quand tu as un bac et que tu dis des vérités. »
E.C. : D’ailleurs, tu as été champion de France de dégustation à 24 ans. Raconte-nous cette histoire incroyable.
A.L. : J’ai eu beaucoup de chance. L’école y inscrivait quelques étudiants. Je n’étais pas trop mauvais. Après avoir passé les sélections départementales et régionales, je me suis retrouvé aux tests du matin pour le niveau national. Ils allaient garder huit finalistes. C’était la fête de l’agriculture, je savais que je n’allais pas être qualifié. Alors, au déjeuner, je me suis mis une bonne murge au cognac. À 14 heures, quand il a fallu se présenter pour les résultats, j’ai eu la surprise de voir que j’étais dans les huit finalistes. Le temps que les autres passent, j’ai pu décuver dans mon box. Le premier verre, je l’ai bu cul sec. Je leur ai demandé un deuxième verre. Et là, j’ai trouvé exactement ce que c’était : un vin de pays de Lunel 50 % chardonnay 50 % viognier avec 17 grammes de sucre résiduel. Ils m’ont demandé comment j’avais trouvé. Je m’en souviens comme si c’était hier. C’était du chardonnay parce que j’avais le côté vanillé du cépage, mais pas de l’élevage, et le côté abricoté du viognier. Et c’était dans le Languedoc et principalement à Lunel qu’on pouvait assembler ces deux-là. Et pour avoir goûté des cuves en cours de fermentation, je savais qu’on était à ce niveau-là de sucre, qu’il y avait un degré d’alcool qui manquait en fermentation. Pour l’anecdote, c’est d’ailleurs là que j’ai rencontré Philippe Faure-Brac, qui a été champion du monde de sommellerie en 1992.
À cette époque, j’étais très affûté. Rien qu’au nez, je pouvais trouver un vin. C’était à force de goûter, tous les jours. Et mon apprentissage du Parker m’avait beaucoup instruit. Aujourd’hui, je n’en serais plus capable.
E.C. : Dirais-tu qu’il est difficile d’entreprendre en France ? En Charente ?
A.L. : Aux États-Unis, on peut créer une société en deux heures. En France, ça dure le temps que tu connais. Ce que je regrette, surtout, c’est que les nouveaux fassent peur et qu’ils ne soient jamais aidés. Ce problème est tout autant charentais que national. Et malheureusement, je crois que ça ne changera pas.
Par exemple, quand je me suis lancé, on m’a dit : « On verra dans dix ans quand tu seras installé. » Je n’avais que des réponses comme ça. Il faut batailler. Heureusement que j’ai obtenu de l’aide auprès de mes amis. Mon réseau a été très utile au niveau technique, mais moins au niveau commercial, la bataille étant la même pour tous.

E.C. : Quels conseils donnerais-tu à celles et ceux qui voudraient créer leur entreprise ?
A.L. : Être passionné par ce que l’on fait ! Rien qu’avec ça, c’est déjà bien parti. Autre chose : la première motivation ne peut pas être le pognon. Si c’est ça, c’est perdu d’avance. J’ajouterais : savoir gérer. Et même savoir se gérer soi-même… C’est là où je suis le moins bon d’ailleurs, savoir ménager la bourrique… pour éviter de trop bosser, au détriment de sa santé, de sa vie familiale. Et en même temps, si on veut que ça marche, il faut bosser. Il n’y a pas de miracle dans la vie. C’est l’éducation que m’ont inculquée mes parents : « Il vaut mieux travailler en perdant de l’argent que d’en gagner à ne rien foutre », disaient-ils.
« J’ai appris le Robert Parker par cœur à l’âge de 20 ans. Chaque week-end et jour de congé, j’ouvrais ce livre, et j’allais dans un vignoble en France pour goûter. »
E.C. : Pour conclure, Antoon, quel maxime ou proverbe te donne de l’élan ?
A.L. : En réalité, j’en ai trois. « Nul bien sans peine » me vient en premier. Cela vient de mon éducation. « Rien n’est primordial mais tout est nécessaire », c’est un prof qui m’avait dit ça. Ça me rappelle qu’une erreur est permise, mais que chaque détail compte quand même à la fin. Et pour finir, j’aime me souvenir qu’« Il faut bien vivre sur terre avant que le ciel nous appelle ».






 Article précédent
Article précédent